world.wikisort.org - France
Saint-Rambert-en-Bugey est une commune française située dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour les articles homonymes, voir Saint-Rambert.
| Saint-Rambert-en-Bugey | |
 Vue du centre de Saint-Rambert-en-Bugey. | |
 Blason |
 |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Belley |
| Intercommunalité | Communauté de communes de la Plaine de l'Ain |
| Maire Mandat |
Gilbert Bouchon 2020-2026 |
| Code postal | 01230 |
| Code commune | 01384 |
| Démographie | |
| Gentilé | Rambertois |
| Population municipale |
2 188 hab. (2019 |
| Densité | 77 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 56′ 49″ nord, 5° 26′ 15″ est |
| Altitude | Min. 271 m Max. 819 m |
| Superficie | 28,55 km2 |
| Unité urbaine | Commune rurale |
| Aire d'attraction | Ambérieu-en-Bugey (commune de la couronne) |
| Élections | |
| Départementales | Canton d'Ambérieu-en-Bugey |
| Législatives | Cinquième circonscription |
| Localisation | |
| Liens | |
| Site web | saint-rambert-en-bugey.fr |
| modifier |
|
Géographie
Localisation
Saint-Rambert-en-Bugey est situé dans le Jura méridional, dans les montagnes du Bugey, au débouché de la vallée de l'Albarine, à 310 m d'altitude.
Communes limitrophes
Climat
Une station météorologique est ouverte le à 296 m d'altitude 45,95028, 5,4611[2].
Saint-Rambert-en-Bugey possède un climat de type semi-continental.
La vallée est située dans une zone climatique de transition : en automne, alors que la plaine de l'Ain, située à quelques kilomètres, se trouve en pleine zone de brouillard, la vallée de l'Albarine reste ensoleillée jusqu'à Torcieu ; la brise de montagne, canalisée par la cluse des Hôpitaux, chasse la brume[3]
Relief et géologie

La partie de la cluse sinueuse où est bâtie la ville est dirigée du nord-est au sud-ouest.
Hydrographie

La ville est traversée dans sa longueur par la rivière Albarine[4] très fréquentée par les pêcheurs à la mouche pour son peuplement en truites fario et en ombres communs.
Trois affluents rejoignent l'Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey :
- la Mandorne, au niveau du lieu-dit le Moulin à Papier ;
- le Brevon, au niveau de l'église ;
- la Câline, à Serrières.
Urbanisme
Typologie
Saint-Rambert-en-Bugey est une commune rurale[Note 1],[5]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[6],[7].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Ambérieu-en-Bugey, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 15 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[8],[9].
La ville de Saint-Rambert-en-Bugey est constituée schématiquement de deux parties distinctes: la "vieille ville", anciennement enceinte dans les murs de la ville, qui étire une double rangée d'habitations anciennes en amont de l'église, et, en aval, des bâtiments (usines, cités ouvrières, maisons de contremaîtres et "châteaux" des propriétaires) de la filature de la Schappe
Saint-Rambert a vu sa richesse architecturale se perdre au fur et à mesure de son histoire.
Dès 1602, son château est détruit. Les remparts sont détruits par des crues, les portes de la ville démontées pour faciliter la circulation, l'abbaye détruite à la suite de la Révolution de 1789.
La révolution industrielle a marqué profondément la physionomie de la cité. On remarque les restes d'un très rare ensemble de cités ouvrières, de villas de contremaitres, de châteaux de directeurs et d'usines textiles datant du XIXe siècle (Schappe).
Autrefois surnommé la « Venise du Bugey[10] » à cause de son canal qui traversait le bourg et de ses fontaines monumentales, Saint-Rambert a vu son canal couvert et ses fontaines détruites lors des opérations de bétonnage des années 1960.

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (70,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (65,2 %), prairies (22,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,6 %), zones urbanisées (3,5 %), zones agricoles hétérogènes (3,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,1 %)[11].
L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].
Voies de communication et transports
Route nationale
La ville est traversée par la route départementale D 1504, ancienne « route nationale 504 ».
Autres routes
- Route d'Angrières • Route de Conand • Route de Grattoux • Route de l'Abbaye • Route de Morgelaz
Voie ferrée

La gare de Saint-Rambert-en-Bugey est située sur la Ligne de Lyon-Perrache à Genève (frontière). Elle est desservie[12] par des trains TER Rhône-Alpes qui effectuent des missions entre la gare de Lyon-Perrache et celles de :
Saint-Gervais ; Évian ; Chambéry-Challes-les-Eaux ; Genève.
La station de Saint-Rambert a été mise en service en 1857 par la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève.
Rues de Saint-Rambert-en-Bugey
Les autres voies de Saint-Rambert-en-Bugey sont[13] :
- Le quai Charles-Béraudier
- Le quai Lamartine
- Le quai Lucien-Franc
- L'avenue de l'Europe
- L'avenue de la Gadinière
- L'Avenue de Savoie
- La rue Brillat-Savarin
- La rue Claude-Mermet
- La rue de l'Abbé-Joseph-Tournier
- La rue de l'Horloge
- La rue de la Grenette
- La rue de la Schappe
- La rue des Blanchères
- La rue des Maisons-Neuves
- La rue des Otages
- La rue du Capitaine-Juvanon
- La rue du Cuchon
- La rue du Docteur-Temporal
- La rue du Moulin
- La rue Eugenie-Lardin
- La rue Hippolyte-Leymarie
- La rue Louis-Fallavier
- La rue Montferme
- La rue Rose-Bichon
- La ruelle de la Fontaine
- La ruelle du Bastion
- L'allée du Four
- Le chemin Neuf
- Le chemin de l'Abbaye
Les hameaux de la commune
- Grattoux, à 1 km au nord-nord-est de Saint-Rambert
- Buges, à 1 km au nord, dans la vallée du Brevon
- Vorages, à 1,5 km au nord-nord-est de Saint-Rambert
- Blanaz, à 2,5 km au sud de Saint-Rambert (alt. : 467 m)
- Lupieu, à 3 km au sud de Saint-Rambert, dans la vallée d'un affluent du Brevon, le Chazet
- Jarvonoz, à 1 km au sud de Saint-Rambert (alt. : 450 m)
- Morgelaz, au pied du Mont Luisandre
- Angrières, à 2,5 km à l'ouest-nord-ouest de Saint-Rambert (alt. : 641 m)
- Serrières, dans le prolongement de Saint-Rambert-en-Bugey, en aval
Toponymie
Au cours des siècles, Saint-Rambert-en-Bugey s'est appelé
- Bebronne au Ve siècle
Hydronyme d'origine gauloise, reposant soit sur une forme gauloise °BEBRŌNNO, soit sur une forme gallo-romane °BEBRŌNE. Le radical BEBR- est celui du gaulois °BEBROS ou °BEBRUS « castor », adapté en bas-latin sous la forme BEBER. Le second élément de l'hydronyme est soit le gaulois ONNO « cours d’eau » (cas le plus probable), soit un suffixe de présence gallo-roman -ŌNE, d'où le sens global de « rivière aux castors », ou éventuellement « endroit où il y a des castors ».

- Bebronna et Bebronnensis locellus au VIIe siècle[14]
avec le latin locellus, diminutif de locus, « lieu »
de Ragnebert qui y fut assassiné en 680.
- Sanctus Ranegbertus en 1137[14]
- Sancto Raniberto en 1206[14]
- Sanctum Rainebertum en 1213[14]
- Sanctus Rainegbertus Jurensis et Sanctus Rambertus en 1275[14]
- Sanctus Renebertus en 1280[14]
- Sanclus Regribertus Jurenfis en 1538[15]
- Sainct Rambert et Sainct Raingbert en 1563[14]
- Saint Rambert-de-Joux au XVIIIe siècle
de par la proximité des Monts Jura ou Mont Joux.
- Montferme sous la Révolution
- Saint-Rambert
- Saint-Rambert-en-Bugey, le [16]
La commune a aussi été surnommée :
- « la Venise du Bugey », au temps de son canal et de ses fontaines monumentales
- « la petite Sibérie », par les troupes allemandes, pendant la guerre de 1939-1945[17]
Les habitants emploient couramment l'abréviation « Saint-Ran »..
Histoire


Antiquité
Charles Athanase Walckenaer donne le district de Saint-Rambert comme étant le territoire des Ambarres[18]
Origines légendaires de la ville
- Saint Domitien[19]
Selon la légende, les origines de la ville de Saint-Rambert remontent à saint Domitien, au Ve siècle. Domitien aurait fondé un monastère et un hospice sur les bords du Brevon, vers 440. Ce « désert », où se cachait précédemment des « faux-monnayeurs », se nommait Bébronne.
- Saint Rambert[20]
Au VIIe siècle, Ragnebert, un noble et pieux chevalier franc (un "leude") est victime d'obscures intrigues de pouvoir sous le règne du « roi fainéant » Thierry III. Exilé dans le Bugey par Ebroïn, le maire du palais, il est assassiné sur ses ordres le , sur le chemin de l'abbaye. Une croix de pierre, placée à quelques pas du pont du Brevon, indique l'endroit où il aurait été mis à mort par deux « sicaires ».
D'après la légende, les prodiges se multiplièrent sur le tombeau de Ragnebert et le lieu devint rapidement un important lieu de pèlerinage. En peu de temps, il se forma sous la protection de l'abbaye un bourg qui prit le nom du martyr. Cette dévotion connaît au XIIe siècle une diffusion régionale en atteignant, par l’intermédiaire du monastère de l’Île Barbe (Saint-Rambert-l'Île-Barbe, Lyon), les comtés de Forez (Saint-Rambert-sur-Loire, Loire) et d’Albon (Saint-Rambert-d'Albon, Drôme).
Les reliques de Rambert et Domitien sont toujours conservées dans l'église paroissiale Saint-Antoine.
Moyen Âge
L’Abbaye de Saint-Rambert se trouve au XIIe siècle à l'apogée de sa puissance. Indépendante de toute suprématie temporelle, elle ne relève que du pape pour la question canonique. Elle possède des domaines jusqu'en Savoie, et se trouve un des petits états les plus riches du Bugey[21]. En 1191, une bulle du pape Célestin III, où l'on énumère les bénéfices de l'Abbaye[22], montre que son étendue était plus considérable que celle du canton actuel.
La construction du château de Cornillon, sur un éperon rocheux au-dessus de la ville, permet à l'Abbaye d'assurer seule son indépendance et sa sécurité.
En 1196, l'abbé Régnier cède à Thomas, comte de Savoie, le château de Cornillon en échange de sa protection.
La guerre contre le Dauphiné
Vers 1282, le conflit entre la maison de Savoie et celle du Dauphiné gagne le Bugey. Situé à la « frontière », Saint-Rambert reçoit en 1288 du comte de Savoie Amédée V des franchises et des privilèges semblables à ceux de la ville de Bourg. Le château de Cornillon, dernier bastion savoyard sur la route qui mène à Pont d’Ain, est une place importante dans cette guerre d'escarmouches, de sièges et d'expéditions punitives. Des chevauchées partent de Saint-Rambert pour aller ravager la plaine de l'Ain[23]. Cette position stratégique va accroitre l'importance du bourg de Saint-Rambert qui s’entoure de remparts et devient une ville de garnison et de stockage du matériel militaire. Le , le traité de Paris met fin au conflit.
Saint-Rambert en Savoie
Le bourg obtient rapidement franchises et privilèges. Il devient notamment la résidence obligée des juge-mages du Bugey et se développe considérablement.
Saint-Rambert reste savoyard jusqu'en 1601 et la signature du traité de Lyon.
Ancien Régime

En 1601, le traité de Lyon rattache Saint-Rambert à la France. Le château de Cornillon est détruit en 1602 par le maréchal de Biron.
En 1607, le duc de Nemours Henri de Savoie obtient du roi Henri IV la réunion des justices s’exerçant sur ses marquisats de Saint-Sorlin et Saint-Rambert et ses baronnies de Chazey, Poncin et Cerdon ; la centralisation se fait à Saint-Rambert, ainsi sauvé de la désertification et de la ruine qui la menaçaient[24] : en effet, la ville doit faire face à la concurrence de la route Lyon-Bellegarde passant par Nantua, plus courte que la route Lyon-Bellegarde passant par Saint-Rambert et Belley (de Bellegarde, on rejoint Genève). En 1607 également, un collège est fondé à Saint-Rambert par Claude Guichard.
L'industrie textile est la plus importante des industries de la ville, reconnue pour l'excellente qualité de sa production de toile de chanvre (nappe, serviette, etc.). Un bureau de visite et de marquage des toiles, créé en 1738, lutte contre les nombreuses malfaçons et contrefaçons.
Les habitants sont pour la plupart pauvres et la ville insalubre. Des épidémies déciment de temps à autre la population. Des tanneurs travaillent en ville (en 1767, il y a cinq tanneries à Saint-Rambert-en-Bugey), malgré les interdictions. Ces commerces locaux empuantissent les alentours. En 1697, la muraille "au devant de l'église" est emportée par une crue.
En 1748, la « porte d'en haut » est détruite pour agrandir le chemin royal de Lyon à Chambéry.
Le don gratuit, la mauvaise gestion des syndics et un mauvais procès contre les Chartreux de Portes, qui réclament que la justice de leur seigneurie de Saint-Sorlin soit rendue à Lagnieu, ruine la ville : en 1771, le parlement de Dijon ordonne que la justice du marquisat de Saint-Sorlin soit exercée à Lagnieu. Les magistrats de Saint-Rambert sont déboutés de leur recours en 1773 et la communauté condamnée à payer les frais du procès. Elle doit piocher dans les économies de l'hôpital pour faire face à cette dépense. Le siège de la justice à Saint-Rambert est disloqué.
Révolution française
Sous la Terreur, la déchristianisation imposant le changement des noms de lieux à consonance chrétienne, Saint-Rambert est rebaptisé Montferme.
Un bataillon de volontaires du district de Saint-Rambert se forme lors de la levée en masse décrétée le . Le bataillon de Montferme combat dans l'Armée des Alpes sous les ordres de Kellerman, puis de Dumas[25].
XIXe siècle

Alphonse de Lamartine nous a laissé cette description de Saint-Rambert au début du XIXe siècle :
- « Peu à peu le défilé s'élargit,le ruisseau grossit, les maisons aussi pittoresques,mais plus nombreuses, se rapprochent sur les deux rives et forment le faubourg d'une petite ville appelée Saint-Rambert. Il n'y a point de rue; la rue, c'est l'Albarine couverte d'une multitude de ponts. Une petite auberge, dont les filets tapissent le mur, puise les écrevisses et les truites sous ses fenêtres et sous son escalier. On soupe et on couche là au bruit et à la fraîcheur du petit fleuve. Quelques usines y joignent le bruit du marteau, quelques moulins le tic-tac des roues. C'est un des lieux les plus pittoresques du monde. »
En mars 1814, lors de la campagne de France qui voit Napoléon Ier tenter d'arrêter l'invasion de la France, des paysans et des gardes nationaux de Tenay et de Saint-Rambert se joignent aux hommes du 23e régiment d'infanterie de ligne et tiennent tête à un détachement de 600 Autrichiens au lieu-dit les Balmettes, vers Torcieu
XXe siècle

La révolution industrielle a profondément marqué la physionomie de la ville. L'histoire de Saint-Rambert au XXe siècle est totalement liée à celle de la filature de la Schappe.
En 1905, l'abbé Tournier, l'un des cofondateurs de la revue Le Bugey, crée à Saint-Rambert la première association de parents d'élèves[26].
En 1908, monsieur Bois, propriétaire, loue pour dix années sa papeterie de Caline pour 12 000 F. l'an (avec faculté de rachat de 300 000 f.) à la société Henri Thouvard et Delafon, d'Entre-deux-Guiers (Isère). Le matériel neuf acheté aux établissements Bouvier et Paul, de Grenoble, permet de pousser la production de 20 tonnes par mois à 120 tonnes par mois. monsieur Bois décède en . Le mois suivant, l'usine est fermée pour cause de guerre puis liquidée. André Navarre, célèbre industriel papetier (et ancien patron d'Henri Thouvard) achète le matériel de l'usine moyennant 420 000 f. Il cède les lieux en 1923 à Voisin & Pascal, sans la machine à papier.
Seconde Guerre mondiale[17]

Le canton de Saint-Rambert-en-Bugey abrite plusieurs groupes de résistants, mais également un noyau organisé de miliciens.
Saint-Rambert fait partie des villes où se fera un dépôt de gerbes clandestins, simultanément au défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
À partir de 1944, l'axe ferroviaire stratégique Ambérieu-Culoz est régulièrement saboté par les maquisards, notamment au pont de Reculafol.
Le , au cours de l'attaque d'un train blindé, 6 soldats allemands sont tués. Simultanément, une patrouille allemande est attaquée dans la ville.
Le , la Wehrmacht et la Gestapo, épaulées par la milice, investissent la ville en guise de représailles. Après une brève tentative de résistance, les maquisards doivent décrocher et se cacher où ils le peuvent.
Des barrages sont établis aux entrées de la ville où de nombreuses personnes sont arrêtées. Plus de 250 ouvriers de la filature de la Schappe sont parqués dans la cour de l'usine, de 14 h 30 à 22 h, et 30 otages, pris au quartier du four-à-chaux, à l'abbaye et à la mairie, sont parqués sous la Grenette (l'ancien marché couvert de Saint-Rambert, mairie actuelle).
Dix-huit otages sont libérés, mais 12 d'entre eux sont mitraillés à 21 h 45 dans la rue du Pavé (actuellement rue des Otages).

Meurent sur le coup :
- Louis Multin, 20 ans, originaire de Druillat et horticulteur à Bourg.
- Le docteur Michel Temporal, 58 ans, maire de la ville ;
- Pierre Chatton, 36 ans, chef du ravitaillement ;
- Louis Golzio, 53 ans, secrétaire de mairie ;
- Dominique Molinero, 43 ans, mécanicien ;
- Joseph Arena, 58 ans, ouvrier ;
- Joanny Pollet, 46 ans, camionneur de Villeurbanne ;
Trois otages, grièvement blessés, seront emmenés à l'hôpital de Nantua. Reconnus lors d'une descente des nazis dans l’hôpital, ils seront fusillés une seconde fois dans la carrière de la Croix-Chalon, certains sur leurs civières. Il s'agit de :
- André Burtschell, 36 ans, juge de paix à Saint-Rambert ;
- Pierre Gayat, 46 ans, secrétaire de mairie ;
- Adrien-Joseph Marguin, 50 ans, garde champêtre.
Deux otages, blessés plus légèrement, s'en sortiront en vie :
- Louis Lannezval, 43 ans, hôtelier et maquisard ;
- Victor de Féo, 41 ans.
Le chauffeur de taxi André Rigaud, arrêté dans la journée à un barrage, passé à tabac et interné à la Schappe, est abattu à 22 heures, lors de la libération des ouvriers. Lors de son arrestation, il était en mission commandée[27] pour le maquis Chico (réseau DITCHER Tiburce-Buckmaster) sous les ordres du capitaine Jean-Paul Archambault.
Centre important de la Résistance, Saint-Rambert-en-Bugey sera décorée de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze[28].
Politique et administration
Tendances politiques
Administration municipale
Liste des maires

Politique environnementale
- Depuis 2002, le Syndicat intercommunal d'aménagement du bassin versant de l'Albarine rassemble 27 communes du bassin versant de l'Albarine, dont la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, pour agir en faveur de l'eau et des milieux aquatiques.
Jumelages
La commune de Saint-Rambert-en-Bugey est jumelée depuis juillet 2022 avec la ville italienne de Rueglio, une petite commune située dans le Piémont.
Population et société
Démographie
Les habitants de la commune sont appelés les Rambertois[29].
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[31].
En 2019, la commune comptait 2 188 habitants[Note 3], en diminution de 2,32 % par rapport à 2013 (Ain : +5,32 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
Enseignement
La ville possède :
- une école primaire : le groupe scolaire Claude-Guichard[34]
- un collège public : le collège de l'Albarine[34]
- Il existait, jusqu'en 2010, une école primaire privée, l'école Sainte-Marie (appelée "l'école d'en haut", par opposition à l'école publique appelée "l'école d'en bas")[34]
- Le groupe scolaire Claude-Guichard.
- Le collège de l'Albarine.
- L'ancienne école privée Sainte-Marie.
Manifestations culturelles et festivités

- Rambert, le saint patron de la ville est célébré le 13 juin. C'est vers cette date que se déroule la Vogue, qui consiste actuellement essentiellement en une fête foraine. On y trouve des manèges pour enfants, des stands de tir et de vendeurs de barbe à papa, des auto-tamponnantes et autres manèges à sensations. Les traditions liées aux conscrits (bals, distributions de brioches aux anciens...) ont disparu au cours des années 1980.
- Chaque soir du 8 décembre, de la même manière qu'à Lyon, les « Illuminations » sont une manifestation populaire où il est de tradition d'illuminer la ville avec des « lumignons », bougies allumées placées dans des verres et déposées sur les rebords de fenêtres.
Santé
On trouve à Saint Rambert :
- L'hôpital Centre Cornillon, un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes/maison de retraite (EHPAD) d'une capacité de 77 lits d'hébergement permanent et de 4 lits d'hébergement temporaire[35].
- Le foyer-logement "Les Blés d'Or" pour personnes âgées de plus de 60 ans[36].
Sports

- L'Étoile du Bugey, le club de rugby historique, crée en 1921 (stade de rugby de la Craz)[37].
- L'Albarine Basket Club compte 103 licenciés, dont 51 mini-basketteurs (- de 10 ans), 18 joueurs de moins de 16 ans, 19 joueurs séniors et 10 loisirs[38].
Médias
L'actualité du canton de Saint-Rambert-en-Bugey est couverte par :
Presse écrite
- Le Progrès, un quotidien régional français appartenant au groupe EBRA.
- La Voix de l'Ain, un journal hebdomadaire appartenant au groupe de presse Hebdomadaires Catholiques Régionaux[39].
- Bugey-Côtière, un hebdomadaire d'information généraliste créé en 2001 et propriété du groupe RC.
Radio
Télévision
- La chaîne France 3 Rhône Alpes Auvergne, une des antennes régionalistes de France Télévisions, émettant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et basée à Lyon.
Cultes
|
Les curés de Saint-Rambert Cl. DUPUY F. DARNAND L. GAMET A. VIVET J. TOURNIER Ad. GAMET J. REUTHER Cl. ARBAN J. DELORME J. ROBIN |
Début 1803 1837 1863 1889 1900 1908 1934 1937 1958 1968 |
Fin 1837 1863 1889 1900 1908 1934 1937 1958 1968 1971 |
Culte catholique
Suivant la tradition, le culte catholique est présent à Saint-Rambert-en-Bugey depuis le Ve siècle. La crypte de Saint-Domitien, réputée pour son architecture romane, daterait du IXe ou Xe siècle[41].
Le culte est aujourd'hui pratiqué à l'église Saint-Antoine.
Saint-Rambert-en-Bugey fait partie avec les villages d'Arandas, Argis, Conand, Nivollet-Montgriffon, Tenay, Torcieu, Blanaz, Oncieu, Evosges, Chaley et Cleyzieu du Groupement paroissial de Saint-Rambert-en-Bugey, du secteur pastoral Ambérieu-Ambronay-Saint-Rambert et du diocèse de Belley-Ars[42].
Économie
Revenus de la population et fiscalité
| Saint-Rambert-en-Bugey | Ain | |
| Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009 | 16 089 € | 25 083 € |
| Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2009 | 40,7 % | 57,3 % |
| Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2010 | 15 855 € | 19 903 € |
Culture locale et patrimoine
Lieux et monuments
Monuments civils
- Ruines du château féodal de Cornillon.
- Maison de Pierre Tournier (pour mémoire)
- La maison forte échoit, en 1308, à la maison de Savoie à la mort de son dernier propriétaire[44].
Monuments religieux
- Crypte romane Saint-Domitien, qui daterait des IXe et Xe siècles[41], restes de l'abbaye, classées au titre des monuments historiques.
- Église Saint-Antoine.
- Église Saint-Antoine.
 Abbaye de Saint-Rambert.
Abbaye de Saint-Rambert.- Crypte de l'abbaye.
- La statue de la Vierge.
- Croix commémorant le martyre de Ragnebert.
Patrimoine naturel
La ville est traversée par la rivière Albarine, essentiellement peuplée à cet endroit de truites fario, d'ombres communs et de vairons. La rivière abrite également à Saint-Rambert une colonie de canards colvert
- Truite fario.

Gastronomie
- Une spécialité très locale, le ramequin, est un fromage de vache sec qui se déguste fondu. C'est un symbole des traditions d'hospitalité bugiste.
- Les bugnes sont une sorte de beignet associés à la période du Mardi-Gras.
- Les bugistes sont souvent des champignonneurs avertis. Les trompettes de la mort, chanterelles et autres bolets font partie intégrante de la gastronomie privée.
- Les truites de l'Albarine.
- Les tartes au sucre ou à la crème.
- Platée de chanterelles.
- Truite Fario.
Patrimoine culturel
- Le Musée des traditions bugistes présente la vie des habitants de la vallée de l'Albarine entre 1840 et 1940[45].
- L’action du roman Beau masque de Roger Vailland se déroule à Saint-Rambert-en-Bugey et romance la lutte des ouvrières de la filature de la Schappe. Une partie du film Beau masque, de Bernard Paul a été tournée à Blanaz, un hameau de Saint-Rambert.
- L'histoire racontée par la bande dessinée Pour la vie[Note 4] se situe essentiellement à Saint-Rambert-en-Bugey où un fait-divers similaire s'est déroulé en 2007[46].
- Travail de Lupieu.
- Four à pain de Blanaz.
- Lavoir de Blanaz.
- Four à pain à Morgelas.
Personnalités liées à la commune
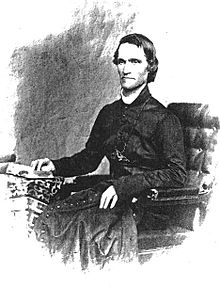
Personnalités
- Charles Béraudier (1920 - 1988), homme politique, député du Rhône et président de la région Rhône-Alpes. Orphelin, il est élevé par ses grands-parents à Saint-Rambert-en-Bugey. Ami d'enfance de Francisque Collomb.
- l'abbé Joseph Tournier (1854 - 1938), précurseur de l'archéologie, de l'étude de la préhistoire et de la géologie du département de l'Ain et fondateur à Saint-Rambert de la première association française de parents d'élèves[47].
- Hippolyte Leymarie (1809 - 1844), peintre et graveur.
- Michel Temporal (1886 - 1944), médecin, capitaine de l'Armée française, maire et médecin de Saint-Rambert-en-Bugey en 1944, pris en otage et fusillé par les nazis à Saint-Rambert-en-Bugey.
- Roger Vailland (1907 - 1965), s'est inspiré de la vie des ouvriers de Saint-Rambert pour son roman Beau masque.
Natifs de Saint-Rambert-en-Bugey
- Bernard Chardère (1930 -), critique de cinéma.
- Francisque Collomb (1910-2009), homme politique, maire de Lyon et sénateur du Rhône.
- Claude Guichard (vers 1545 -1607), historiographe de la Maison de Savoie.
- Claude Mermet (vers 1550 -1620), poète, notaire.
- Antoine Mermet de Saint-Landry[48] (1738-?), général des armées de la République, né dans la commune.
- Antoine Marie Garin (1810 -1889), missionnaire, pédagogue, un des pères du système éducatif néozélandais.
- Remy Himmer (1849 - 1914), industriel français, fusillé par les troupes allemandes le à Leffe (Dinant).
- Giuseppe Pognante (1894 - 1985), peintre italien, membre des Ziniars[49].
Héraldique
 |
La commune de Saint-Rambert-en-Bugey porte :
En 1262, la ville portait « D'or à un geai ou passereau de sable, au chef de Savoie" »[51]. Le chef de savoie a été remplacé par un chef de France en 1601. L'oiseau est désormais désigné comme une corneille (probablement à cause du château de Cornillon). |
|---|
Voir aussi
Bibliographie
- Jean-Claude Marquis, Le canton de Saint-Rambert-en-Bugey (Ain) : vous connaissez ?, , 175 p. (lire en ligne)
Articles connexes
- Liste des communes de l'Ain
- Saint-Rambert-l'Île-Barbe
- Saint-Rambert-sur-Loire
- Saint-Rambert-d'Albon
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Site officiel
Notes et références
Notes et cartes
- Notes
- Selon le zonage publié en décembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.
- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.
- Pour la vie, (ISBN 978-2-203-02498-4), dessinateur : Claudio Stassi, scénario : Jacky Goupil.
- Cartes
- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.
Références
- ([PDF] Cartes des communes de l'Ain), sur ain.fr.
- « Fiche du poste 01384003 », données publiques de la station Météo-France [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).
- Isabelle Trautsolt, Annales de Géographie, vol. 428, (lire en ligne), Recherches sur les climats du Jura français, « L'influence du relief sur la température et l'insolation », p. 424.
- Sandre, « Fiche cours d'eau - L'Albarine (V29-0400) » (consulté le )
- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )
- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le )
- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le )
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
- paragr. « Saint Rambert en Bugey 03/04/2014 », sur rsnantua.nexgate.ch (consulté le ).
- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )
- « Informations pratiques sur les gares et arrêts : Halte ferroviaire de St-Rambert-en-Bugey », SNCF TER Rhône-Alpes, sur ter-sncf.com (consulté le ).
- « Rue de Saint-Rambert-en-Bugey », sur annuaire-mairie.fr (consulté le ).
- Henry Suter, « Noms de lieux de Suisse Romande, Savoie et environs », glossaire (consulté le ).
- [Diderot 1777] Denis Diderot, Supplément À L’Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné Des Sciences, Des Arts Et Des Métiers, t. 3, , sur books.google.fr (lire en ligne).
- « Histoire de Saint-Rambert-en-Bugey », sur annuaire-mairie.fr.
- Jacqueline Di Carlo, La guerre de 1939-1945 dans le canton de Saint-Rambert-en-Bugey, épisodes, District de la vallée de l'Albarine, (ISBN 2-907881-12-4 et 9782907881128).
- [Walckenaer 1839] Charles-Athanase Walckenaer, Géographie ancienne historique et comparée des Gaules cisalpine et transalpine, t. 2, Paris, P. Dufart, , sur gallica.bnf.fr (lire en ligne).
- [Depérys 1834] Jean-Irénée Depérys, Histoire hagiologique de Belley : recueil des vies des saints et des bienheureux nés dans ce diocèse, t. 1, Bottier, , 404 p. (lire en ligne), « Saint Domitian », p. 11-20.
- [Depérys 1834] Jean-Irénée Depérys, Histoire hagiologique de Belley : recueil des vies des saints et des bienheureux nés dans ce diocèse, t. 1, Bottier, , 404 p. (lire en ligne), « Saint Ragnebert », p. 89-103.
- [Leymarie 1854] Hippolyte Leymarie, Notice historique et descriptive sur la ville et l'abbaye de Saint-Rambert-de-Joux, impr. Aimé Vingtrinier, , 69 p. (lire en ligne), chap. 2 (« L'abbaye »), p. 21.
- Samuel Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey, , sur books.google.ch (lire en ligne).
- [Kersuzan 2005] Alain Kersuzan, Défendre la Bresse et le Bugey : les châteaux savoyards dans la guerre contre le Dauphiné, 1282-1355, Presses Universitaires de Lyon, , sur books.google.ch (lire en ligne).
- [Perrot 1988] Marc Perrot, St-Rambert-en-Bugey et la vallée de l'Albarine sous l'ancien régime : XVIIe – XVIIIe siècle, , sur books.google.fr (lire en ligne).
- « Blog de la Société d’Études Historiques Révolutionnaire et Impériales », sur empireetrevolution.fr.
- « Statuts de l'Association des familles du Canton de Saint-Rambert », sur gallica.bnf.fr.
- « Visionneuse - Mémoire des Hommes p188 », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le )
- « Liste des communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945 » [PDF], sur memorialdormans.free.fr.
- « Nom des habitants des communes françaises, Saint-Rambert-en-Bugey », sur habitants.fr, SARL Patagos (consulté le ).
- L'organisation du recensement, sur insee.fr.
- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
- « Etablissements scolaires à Saint-Rambert-en-Bugey », sur education.gouv.fr (consulté en ).
- « L'EHPAD - Centre Cornillon », sur etablissements.hopital.fr (consulté en ).
- ,Les Blés d'Or sur le site saint-rambert-en-bugey.fr.
- « Site officiel de l'EDB », sur edbrugby.free.fr.
- Albarine Basket Club - Saint-Rambert-en-Bugey - Site officiel de la commune,Albarine Basket Club.
- « Qui sommes-nous ? », sur voixdelain.fr (consulté le ).
- « Fréquence Côtière radio (FC Radio) », sur 100ansderadio.free.fr (consulté le ).
- « La crypte Saint-Domitien à Saint-Rambert », sur leprogres.fr, Le Progrès, (consulté le ).
- « Le Groupement paroissial de Saint-Rambert-en-Bugey », sur catholique-belley-ars.cef.fr.
- « Statistiques locales », INSEE [PDF].
- [Kersuzan 2014] Alain Kersuzan, « Maisons et maisons fortes dans le comté de Savoie (XIVe – XVe siècle) - Essai de terminologie d'après les sources comptables », dans Chastels et Maisons fortes IV (Actes des journées de castellologie de Bourgogne 2010-2012), CECAB, (ISBN 978-2-9543-8212-8), p. 145-155.
- « Musée des Traditions Bugistes », sur ain-tourisme.com (consulté le ).
- Frédéric Potet et Marion Van Renterghem, « Ces couples âgés qui ont choisi de « quitter la vie » ensemble », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ) :
« En juillet 2007, à Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), un couple s'était échappé d'une maison de retraite pour se jeter sous les roues d'un train. Lui avait 81 ans et avait commencé à travailler comme typographe, à l'âge de 12 ans. Elle en avait 83 et avait entamé une carrière d'employée de bureau avant d'acheter un bar avec son mari, puis un hôtel-restaurant. Ils n'avaient pas eu d'enfants et s'aimaient d'un amour brûlant. La perspective que l'un puisse disparaître avant l'autre fût-elle pour autant l'unique motif de leur décision ? »
. - [Lanfrey 2003] André Lanfrey, Sécularisation, séparation et guerre scolaire : Les catholiques français et l'école (1901-1914), Paris, éd. du Cerf, , 632 p., sur books.google.fr (lire en ligne), p. 235.
- dans [Six 1934] Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814), , « Mermet de Saint-Landry (Antoine) », p. 186-187.
- [Fenéon et Janneau 1920] Félix Fenéon et Guillaume Janneau, Le Bulletin de la vie artistique, Paris, Bernheim-jeune, , sur gallica (lire en ligne), p. 717.
- Armes de Saint-Rambert-en-Bugey, sur labanquedublason2.com.
- Armorial des communes et collectivités des pays de l'Ain.Chaix P.-H
- Portail de l’Ain
- Portail du Bugey
- Portail des communes de France
На других языках
[de] Saint-Rambert-en-Bugey
Saint-Rambert-en-Bugey ist eine französische Gemeinde mit 2188 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Ambérieu-en-Bugey im Arrondissement Belley.[en] Saint-Rambert-en-Bugey
Saint-Rambert-en-Bugey (French pronunciation: [sɛ̃ ʁɑ̃bɛʁ ɑ̃ byʒɛ] (listen), literally Saint-Rambert in Bugey) is a commune in the Ain department in eastern France.[es] Saint-Rambert-en-Bugey
Saint-Rambert-en-Bugey es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.- [fr] Saint-Rambert-en-Bugey
[ru] Сен-Рамбер-ан-Бюже
Сен-Рамбе́р-ан-Бюже́ (фр. Saint-Rambert-en-Bugey) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Сен-Рамбер-ан-Бюже. Округ коммуны — Белле.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии




























