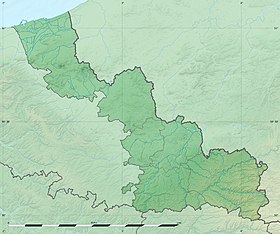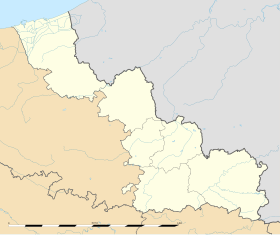world.wikisort.org - France
Fort-Mardyck (prononcer [fɔʁ maʁdik]; Fort Mardijk[1] en flamand occidental) est une ancienne commune française, située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France ; elle est associée à Dunkerque depuis le .
| Fort-Mardyck | |
 L'église | |
 Héraldique |
 |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Dunkerque |
| Commune | Dunkerque |
| Intercommunalité | Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral |
| Statut | Commune associée |
| Maire délégué Mandat |
Grégory Bartholoméus (2020-2026) |
| Code postal | 59430 |
| Code commune | 59248 |
| Démographie | |
| Gentilé | Fort-Mardyckois |
| Population | 3 403 hab. (2019 |
| Densité | 2 413 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 51° 01′ 52″ nord, 2° 18′ 22″ est |
| Altitude | Min. 2 m Max. 9 m |
| Superficie | 1,41 km2 |
| Élections | |
| Départementales | Dunkerque-1 |
| Historique | |
| Date de fusion | |
| Commune(s) d'intégration | Dunkerque |
| Localisation | |
| modifier |
|
Géographie

Situation
Située dans la banlieue Dunkerquoise, Fort-Mardyck est reliée à Lille (80 km) et Paris (300 km) par l'autoroute A25, au Tunnel sous la Manche via Calais par l'A16/E40, et à Bruxelles par l'A16/E40. Liaisons ferroviaires directes au départ de Dunkerque à destination de Calais, Lille, Paris, Marseille. Canal à grand gabarit jusqu'à Valenciennes. La commune est désservie par les lignes 17 et 19 du réseau DK'Bus
Héraldique

|
Les armes de Fort-Mardyck se blasonnent ainsi :"Champs de gueules à la licorne saillante d'argent, au chef d'azur chargé d'un soleil à face humaine, rayonnant d'or, enfermé dans une bordure bretessée aussi d'or."
|
|---|
Communes Limitrophes
Drapeau
La ville de Fort-Mardyck utilise son propre drapeau que se décrit ainsi "Fascé de quatre pièces d'argent et de gueules.

Histoire

La commune tire son nom du fort construit en 1622 sous la domination espagnole, pour protéger la passe ouest de Dunkerque. Le récit du siège de Mardyck en 1645 indique :
- « Le fort de Mardijck est situé dans les dunes ou monts de sable sur le rivage de la mer, à environ 1 heure de Duynkercke, et quasi à même distance du village de Mardijck, duquel village ce fort susdit tire son nom, ayant été bâti à la faveur de ceux de Duynkercke par le commandement du très célèbre chef de guerre Ambrose Spinola, et ce pour tant plus faciliter et assurer l'entrée et la sortie du havre attendu que les États des Provinces Unies avaient quelques-uns de leurs navires de guerre à la rade devant ou aux environs de Duynkercke pour y guetter les Duynkerkois et leur disputer l'entrée et sortie, et pour empêcher aussi que les navires pris par ceux de Duynkercke ne pussent surgir au port comme ainsi soit que nécessairement il leur fallait roder la cote de fort près et passer le long du canal dit le Scheurtje par y décliner nos navires, desquels néanmoins ils furent souvent poursuivis et à grand-peine qu'il en échappèrent. Pour obvier à ceci les Duynkerkois, comme dit, on mis tout au bout du rivage, voire partie en mer, un Boulevard de Bois qu'ils appellent « Block-huys »[2]; lequel ils fondirent si bien sur des pilotis, qu'ils purent commodément planter 6 à 7 demi-cartouches, pour la défense de leurs navires et pour repousser de là l'ennemi. Lequel boulevard, étant de bois, reçut de là le nom de « Houte Wambas » c'est à dire « pour-point de bois ». Or pour la sureté de ce fort de bois fut encore construit en terre un autre fort avec 4 bataillons royaux, assis dans les dunes, lequel pour la bonne commodité, fut agrandi de grands dehors et renforcé de plusieurs maisons représentant presque une petite ville »[3],[4].
- 30 septembre 1657 – 3 octobre : siège et prise de la ville par l’armée française, commandé par le chevalier de Clerville[5] et Vauban[6].
- 1662 : après la victoire de Turenne lors de la Bataille des Dunes, Louis XIV rachète Dunkerque et le fort de Mardyck aux Anglais. Colbert, ministre de la marine, installe une colonie de marins venue de Picardie sur l'emplacement du fort. L'originalité de cette création fut que les familles qui s'y implantèrent reçurent une "dot agraire communale" de 24 ares donnée à tout jeune couple qui s'y établit[7]. Louis XIV serait passé deux fois à Fort Mardyck en 1658 et 1662. Les premiers habitants eurent des maisons en torchis et chaumes. Autre particularité ils parlaient français alors qu'autour d'eux on pratiquait le flamand[7]. Ils étaient marins et pêcheurs. En 1677, la colonie comptait trente familles qui fournirent leur lot de marins pour les guerres des Rois de France. Par la suite nombre de villageois deviendront pêcheurs d'Islande, à la recherche de la morue, activité très difficile, le froid, l'humidité, les tempêtes, le travail harassant, la navigation périlleuse; pour les marins cela signifie "de la glace, des rochers et de la misère!» selon le mot d'un ancien [7]. En 1905, 36 marins ne revinrent pas de la campagne de pêche[7],[8].
- 1793 : le hameau devient commune.
- 1800 : le hameau est rattaché à la commune de Mardyck.
- 1830 : rattachement à la commune de Grande-Synthe.
- 1868 : le hameau redevient une commune indépendante.
- 1910 : le 20 novembre, une baleine de 19 mètres (40 000 kg) s'échoue sur la plage de Fort-Mardyck[9].
- Pendant la première guerre mondiale, Petite-Synthe est en 1917-1918, le siège d'un commandement d'étapes, c'est-à-dire un élément de l'armée organisant le stationnement de troupes, comprenant souvent des chevaux, pendant un temps plus ou moins long, sur les communes dépendant du commandement, en arrière du front. Fort-Mardyck fait partie de ces communes et a accueilli des troupes à ce titre[10].
- Le 18 décembre 1917, un bombardement aérien a frappé entre 17h 50 et 18h 45 les communes de Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe et Fort-Mardyck[11].
- Le 26 janvier 1918, bombardement sur l'agglomération dunkerquoise, d'abord terrestre vers 23h30, puis aérien vers 0h25. Le bombardement terrestre a concerné Saint-Pol-sur-Mer (un obus de 380 tombé 72 rue de la République, dégâts matériels), et Rosendaël (un obus de 380 tombé sur l'abattoir, dégâts matériels). Le bombardement aérien a vu une bombe larguée sur Malo-les-Bains, (rue de Roubaix, plusieurs automobiles militaires endommagées) et deux torpilles lancées sur Fort-Mardyck (elles n'ont pas explosé, pas de victimes)[12].
- 2004 : le 5 décembre les habitants de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont consultés par référendum sur la fusion-association à la ville de Dunkerque. Le oui l'emporte à 54 %, mais n'obtient que 24,25 % des inscrits au lieu des 25 % exigés par la loi. La fusion-association est donc rejetée par le préfet.

- 2010 : à la suite de la décision du Conseil d'État d'annuler l'arrêté du préfet (CE 20 octobre 2010, no 306643, commune de Dunkerque : AJDA, 4 avril 2011, p. 686, note A. Treppoz Bruant), le projet de fusion est de nouveau à l'ordre du jour[13].
- : le préfet ayant autorisé les conseils municipaux à statuer de nouveau sur le sort du projet, les 3 conseils municipaux votent une nouvelle fois en faveur de la fusion-association.
- : le préfet ayant pris acte de la volonté des conseils municipaux, il accepte la fusion qui prend effet le [14].
Politique et administration
Fort Mardyck est une commune associée à Dunkerque depuis le 9 décembre 2010, elle dispose donc d'un conseil consultatif présidé par un maire délégué. Les membres de ce conseil siègent également au conseil municipal de Dunkerque. Le maire Délégué de Fort Mardyck est actuellement Grégory Bartholoméus.
La commune associée appartient également au Canton de Grande-Synthe, qui comprend une partie de Dunkerque-Petite-Synthe, les communes associées de Mardyck et de Fort-Mardyck. L'actuel conseiller général est aussi Roméo Raggazzo.
Liste des maires
Liste des maires-délégués
Politique de développement durable
La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21[32].
Démographie
Évolution démographique
L'évolution du nombre d'habitants depuis 1793 est connue à travers les recensements de la population effectués à Fort-Mardyck depuis cette date :
Pyramide des âges
Économie
La tradition des marchés se poursuit sur la commune : marché chaque vendredi matin.
Lieux et monuments
Parc zoologique
Fort-Mardyck est le lieu d'implantation d'un parc zoologique, abritant environ 170 individus et plus d'une quarantaine d'espèces sauvages et domestiques, vivant dans un milieu de vie reconstitué.
Personnalités liées à la commune
- Angelo Hugues
- Gilbert Zoonekynd, footballeur français.
Notes et références
- « proussel.voila.net/pages/noms_… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- Fort pour défendre l'entrée d'un havre, bastion, boulevard - page78
- Bref récit touchant le fort Mardyck avec le sit, siége et prise d'iceluy l'an 1645
- M. Millon : Les ouvrages militaires de Mardyck
- Anne Blanchard, « Louis Nicolas de Clerville», in Actes du colloque « Vauban et ses successeurs dans les ports du Ponant et du Levant », Brest, 16-19 mai 1993, publié dans Vauban et ses successeurs dans les ports du Ponant et du Levant, Paris : Association Vauban, 2000, p. 123 (également publié dans Les cahiers de Montpellier no 38, tome II/1998, Histoire et Défense, Université Paul-Valéry).
- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, , 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p. 164.
- Dr Lancry, <<La dot agraire communale à Fort Mardyck et à Beuvraignes>>, dans Congrès des Sciences Historiques en juillet 1907, Tome II, pages 165 à 186, lire en ligne
- « Dunkerque et vous »
- Cent ans de vie dans la région, Tome 1 : 1900-1914, éditions la Voix du Nord, 1998, page 57
- « Journaux des marches et opérations des corps de troupe - Mémoire des hommes », sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (consulté le )
- Journal de marche du commandement d'étapes de Petite-Synthe, novembre 1917-janvier 1918, page 30, lire en ligne.
- Journal de marche du commandement d'étapes de Coudekerque-Branche, janvier-mars 1918, page 26, lire en ligne.
- « La fusion de nouveau d'actualité », sur http://www.lavoixdunord.fr, La Voix du Nord (consulté le ).
- « Le préfet du Nord prononce la fusion association de Dunkerque, Saint-Pol et Fort-Mardyck », sur http://www.lavoixdunord.fr, La Voix du Nord (consulté le ).
- Archives départementales du Nord - Registre d'état civil
- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord Année 1883
- Annuaire Ravet-Anceau Département du Nord Années 1887-1888
- Annuaires Ravet Anceau Département du Nord Années 1889 à 1892
- Annuaire Ravet Anceau Département du Nord 1893 à 1896
- Annuaire Ravet-Anceau Département du Nord Année 1897
- également orthographié B.-J.-F. Evrard. Probablement de la même famille que J. Everrard ci-dessus
- Annuaires Ravet-Anceau Département du Nord Années 1899 à 1904
- Annuaire Ravet-Anceau Département du Nord Années 1905 à 1908
- http://collegedeconinck.fr/spip/spip.php?article17
- http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/linstitution/lorganisation-politique/les-vice-presidents/index.html
- « Résultats des élections départementales 2015 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-2015 (consulté le ).
- À la suite de la démission de Christian Hutin lors du Conseil communautre du 19 octobre 2017
- https://reader.cafeyn.co/fr/1926576/21598579
- B.C., « Grégory Bartholoméus élu haut la main dès le premier tour à Fort-Mardyck », La Voix du Nord, (lire en ligne
 , consulté le ).
, consulté le ). - https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fileadmin/user_upload/Trombinoscope_-_conseil_communautaire_juillet_2020_-_communaute_urbaine_de_dunkerque.pdf
- https://www.lepharedunkerquois.fr/119157/article/2021-06-27/canton-de-dunkerque-1-pas-d-union-face-au-rassemblement-national
- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Fort-Mardyck, consultée le 26 octobre 2017
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
- « Évolution et structure de la population à Fort-Mardyck en 2007 », sur le site de l'Insee (consulté le )
- « Résultats du recensement de la population du Nord en 2007 », sur le site de l'Insee (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Anciennes communes du Nord
- Communes du Nord
Liens externes
- Notices d'autorité :
- Site de la ville
- Fort-Mardyck sur le site de l'Institut géographique national
- Portail des Flandres
- Portail de Dunkerque
- Portail des communes de France
- Portail du Nord-Pas-de-Calais
- Portail de la Côte d'Opale
На других языках
[de] Fort-Mardyck
Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Frankreich/Wartung/abweichendes Wappen in Wikidata- [fr] Fort-Mardyck
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии