world.wikisort.org - France
Narnhac est une commune française située dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
| Narnhac | |
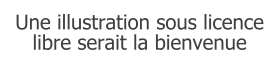
| |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Cantal |
| Arrondissement | Saint-Flour |
| Intercommunalité | Saint-Flour Communauté |
| Maire Mandat |
Jean Mezange 2020-2026 |
| Code postal | 15230 |
| Code commune | 15139 |
| Démographie | |
| Population municipale |
68 hab. (2019 |
| Densité | 6,6 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 55′ 46″ nord, 2° 46′ 47″ est |
| Altitude | Min. 756 m Max. 1 110 m |
| Superficie | 10,29 km2 |
| Unité urbaine | Commune rurale |
| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |
| Élections | |
| Départementales | Canton de Saint-Flour-2 |
| Législatives | Deuxième circonscription |
| Localisation | |
| modifier |
|
Géographie
La commune de Narnhac se situe sur le canton de Saint-Flour-2, au sud-est du Cantal. D’une superficie de 10,29 km2, elle jouxte les communes de Malbo, Saint-Martin et la commune de Thérondels dans l’Aveyron. Elle est bordée par deux cours d’eau, l’Hirondelle, à la limite de Saint-Martin et le Siniq qui descend des hauteurs du Plomb du Cantal en limite avec Malbo. Le bourg se situe à 2 km de la D 990 reliant Aurillac à Pierrefort et Saint-Flour.
Narnhac se présente comme une commune de semi-altitude (entre 756 m et 1 110 m) typique du Barrès avec ses paysages vallonnés constitués essentiellement de pâturages. Une forêt communale de sapins de 11 ha et plusieurs forêts privées plantées de sapin et de chênes viennent ponctuer ce paysage rural.
La cascade de Borie et une grotte située à proximité, la grotte des Cuzeaux, s’inscrivent sur le cours de l’Hirondelle. La cascade porte le nom d'Armand Bory[réf. nécessaire] qui fut député sur l’arrondissement et à qui l’on doit, notamment, l’édification de la Maison de retraite de Pierrefort.
Le site de Borie, outre la cascade et la grotte, recèle une autre curiosité géologique : l'Hirondelle a creusé une voûte sous la coulée de lave qui couvre le plateau de Lebréjal. Elle a emmené le substratum très tendre sur une épaisseur de 4 à 5 m. Ce travail d'érosion du support permet d'observer du dessous la prismation de la coulée. Les prismes de basalte sont larges puis plus étroits sous l'effet d'un refroidissement plus rapide vers la surface.
En plus de la cascade de Borie sur l'Hirondelle, il convient de citer aussi la cascade de Gascou sur le ruisseau de Moissalou. Le saut de Gascou comme on dit localement se situe en contrebas de la D 990, à l'aplomb de Falies. Le Moissalou fait office de limite entre le Cantal et l'Aveyron d'une part, et, Narnahac et Thérondels d'autre part, sur la portion qui va de son franchissement par la D 990 au confluent de l'Hirondelle.
La configuration du département du Cantal ressemble à un camembert auquel une portion a été ôtée. La part manquante correspond à la pénétration du département de l'Aveyron dans celui du Cantal. Le centre de ce camembert se situe sur la commune de Narnhac, sur l'axe de la route D 401 qui monte vers Chatours et à 600 m au nord de son croisement avec la D 990. À ce point précis on assiste à la triple rencontre entre Narnhac, Malbo et le département de l'Aveyron.
Communes limitrophes
 |
Malbo | Malbo | Malbo |  |
| Malbo | N | Saint-Martin-sous-Vigouroux | ||
| O Narnhac E | ||||
| S | ||||
| Thérondels (Aveyron) |
Urbanisme
Typologie
Narnhac est une commune rurale[Note 1],[1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2],[3]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 1],[I 2].
Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (77,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (80,8 %), forêts (18,6 %), zones humides intérieures (0,6 %)[4].
L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].
Habitat et logement
En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 78, alors qu'il était de 77 en 2013 et de 76 en 2008[I 3].
Parmi ces logements, 50,1 % étaient des résidences principales, 42,4 % des résidences secondaires et 7,5 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 92,2 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 7,8 % des appartements[I 4].
Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Narnhac en 2018 en comparaison avec celle du Cantal et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (42,4 %) supérieure à celle du département (20,4 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 78,9 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (82,9 % en 2013), contre 70,4 % pour le Cantal et 57,5 pour la France entière[I 5].
| Typologie | Narnhac[I 3] | Cantal[I 6] | France entière[I 7] |
|---|---|---|---|
| Résidences principales (en %) | 50,1 | 67,7 | 82,1 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 42,4 | 20,4 | 9,7 |
| Logements vacants (en %) | 7,5 | 11,9 | 8,2 |
Toponymie
Origine du nom de la commune : Largnac en 1687, Larniat en 1662, Marnhac en 1628, Narnac en 1559, Narnhacum en 1433, Vernhac ou Verniacum au XIVe siècle = lieu où poussent les vergnes.
Histoire
Le , des soldats ont été tués et le maire, Antoine Aldebert, ainsi qu’une autre personnalité de la commune, Bertrand Vidalenc, ont été fusillés devant la population. Une stèle commémore cet évènement.
Politique et administration
Population et société
Démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[6]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[7].
En 2019, la commune comptait 68 habitants[Note 2], en diminution de 8,11 % par rapport à 2013 (Cantal : −1,59 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
Manifestations et festivités
La commune de Narnhac est à l’origine de la création d’une amicale nommée « Amicale Lou Pé d’Andel » en 1902. Réunissant d’abord les trois communes de Narnhac, Malbo et Lacapelle-Barrès, elle tire ainsi son nom du trépied utilisé dans les cheminées pour porter au feu la marmite (les pieds de l’andel). Les trois pieds sont devenus quatre avec l’adjonction de la commune de Saint-Martin-s-Vigouroux. D’abord organisée sur trois jours, elle réunissait les habitants des différentes communes autour de repas, bien sûr (notamment la soupe aux choux et la potée auvergnate), mais aussi des concours de belote et de pétanque, une brocante, une tombola, et finissait par le bal. Une messe accompagnait ces festivités. Chaque année, on changeait de commune. En 2009, Narnhac a accueilli sous chapiteau 216 personnes, habitants à l’année, vacanciers, membres de la famille, de passage. Mais cette manifestation regroupant aussi « les Auvergnats de Paris », un repas est organisé en hiver dans la capitale. L’amicale se nomme aujourd’hui « Rencontres d’été des amis du Pé d’Andel ». Les Auvergnats de Paris rentreraient-ils sur leur terre ?
Sur ce versant culturel, notons que la commune a accueilli en 2009 la réalisation d’une pièce de théâtre, dans le cadre de la « Ballade culturelle du Pays de Pierrefort ».
La commune compte aussi une société de chasse.
Enseignement
L’école communale de Narnhac, organisée en regroupement pédagogique avec Saint-Martin-sous-Vigouroux, a fermé ses portes en 2008.
Économie
Comme beaucoup de communes du canton, l’habitat est dispersé (8 habitants au km2). On ne compte pas moins de cinq hameaux : Nouvialle, Moissalou, Pont la Vieille, Belmont et Cantaloube. Le bourg lui-même regroupe autour de lui quatre « villages » : la Serre, la Goutte, la Parro et le Mas Bertrand. Malheureusement, comme la plupart des communes alentour, la population a fortement diminué, passant de 224 habitants en 1962 à 84-86 depuis 1999. Bien sûr, les commerces et l’artisanat ont suivi ce dépeuplement. On comptait encore, dans les années cinquante, quatre cafés, une boucherie « multiservice » et un bureau de poste qui assurait également un « courrier » pour les habitants, reliant les gares de Neussargues et Aurillac via Pierrefort. On comptait également un menuisier, un plombier, un forgeron...
Culture locale et patrimoine
Lieux et monuments
L’église Saint-Pierre-aux-Liens possède un porche à colonnettes. Le clocher à peigne comportait quatre cloches dont l’une, classée à l’inventaire des monuments historiques, date de 1513 et attend aujourd’hui sa restauration. Deux autres cloches ont disparu.
Le petit patrimoine est nombreux et a fait, pour la plupart, l’objet de restauration : cinq fours à pains, un lavoir, une fontaine, plusieurs croix et oratoires et les ruines d’un ancien moulin.
MOISSALOU est l'éponyme du ruisseau qui traverse ses terres. En 1668 ce village s'appelait Moissalhoux. Après dissection voici l'étymologie de ce sympathique hameau : "moisse-al-osa" = ruisseau bordé de zones marécageuses // Massales, Moissac, Moissinac, Moisset, Massiac, Moussages...
Personnalités liées à la commune
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des communes du Cantal
Liens externes
- Chiffres-clés de Narnhac (15139), sur le site de l'Insee
- Narnhac, sur le site de l'Institut géographique national
Notes et références
Notes et cartes
- Notes
- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.
- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2022, millésimée 2019, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2021, date de référence statistique : 1er janvier 2019.
- Cartes
- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.
Références
Site de l'Insee
- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).
- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Narnhac » (consulté le ).
- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Narnhac - Section LOG T2 » (consulté le ).
- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Narnhac - Section LOG T7 » (consulté le ).
- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans le Cantal » (consulté le ).
- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).
Autres sources
- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).
- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).
- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )
- Annuaire des maires du Cantal, sur le site de l'AMF15 (consulté le 18 octobre 2019).
- L'organisation du recensement, sur insee.fr.
- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
- Portail des communes de France
- Portail du Cantal et de la Haute-Auvergne
На других языках
[de] Narnhac
Narnhac ist eine französische Gemeinde mit 68 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) im Département Cantal in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Saint-Flour-2 und zum Arrondissement Saint-Flour.[en] Narnhac
Narnhac is a commune in the Cantal department in south-central France.- [fr] Narnhac
[ru] Нарньяк
Нарнья́к (фр. и окс. Narnhac) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Пьерфор. Округ коммуны — Сен-Флур.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии




